A l’heure de la généralisation des passeports biométriques, qui s’inquiéterait de ces banales cartes d’étudiantes à code-barres mises en place en 2009 à l’Université de Genève ? Alors que la frénésie policière bat son plein avec l’opération Figaro, qui s’offusquerait de quelques uniformes patrouillant au cœur des bâtiments académiques sous l’œil de verre des caméras de vidéosurveillance ? Et quel mauvais esprit ne saluerait pas les efforts du rectorat pour être aux premières loges de cette grand-messe de la sécurité en créant un certificat en gestion des politiques de sécurité urbaines?
Nous sommes de celles-là, plutôt Cassandre que la tête dans le sable. L’attitude de l’autruche consiste à considérer toute mesure comme anodine et nécessaire d’un stricte point de vue utilitaire en cachant aux autres et parfois aussi à soi-même ses implications politiques et ses effets sur la société. Nous préférons crier au loup, car il est déjà dans les chaumières. Ce texte revient sur certaines de ces évolutions à l’Université de Genève, des nouvelles cartes étudiantes aux agents de sécurité en passant par les caméras de vidéosurveillance, et pose la question de ce qu’elles peuvent engendrer.
Il y a quelques décennies étaient introduites les premières cartes d’étudiantes à l’Université de Genève. Sur un support carton, on collait la photo de la détentrice et un nouveau justificatif pour chaque semestre d’étude. Depuis sa création, elle a permis à plusieurs occasions de restreindre l’accès aux bâtiments universitaires aux non étudiantes. Par exemple, on en a interdit l’accès lors de la période de mobilisation contre le sommet du G8 à Evian en 2003 et, la même année, à l’occasion des cortèges collégiens de l’Escalade, après qu’Uni-Mail ait perdu un peu de son austérité et de son mobilier lors de la joyeuse traversée du cortège de l’année précédente.
En 2009, les nouvelles cartes d’étudiantes étaient mise en place. Elles rassemblent en une seule les cartes de bibliothèque, de photocopie et d’étudiante. La plupart de ses fonctions utilisent le code-barres visible sur la carte, mais elle est également « munie d’un circuit électronique miniature de type RFID1 permettant une identification de la carte au moyen de lecteurs de cartes à puce sans contacts »2.
Même sur les cartes d’identité, l’État n’a pas encore appliqué cette sinistre idée. À terme, cette technologie devrait permettre d’identifier et de localiser partout quiconque utilise sa carte d’étudiante. Cela risque d’être de plus en plus fréquent puisque le regroupement des services sur ce seul objet semble être la tendance. Il serait même possible de connaître les allées et venues d’une heureuse détentrice de cette carte à puce. Mais, comme l’EPFL a les mêmes, l’Université de Genève ne peut tout de même pas être à la traîne.
Le domaine de la sécurité est de fait devenu un enjeu économique de taille et chaque université ou haute école veut la part du lion. Et il est évident qu’en matière de prestige et surtout de retombées économiques, il vaut mieux être à la pointe en technologie de fichage ADN ou en micro-électronique qu’en hacking. L’université devient à la fois le lieu d’expérimentation et de promotion de nouvelles technologies, soit par la pression des lobbys qui contrôlent plus ou moins directement une grande part de la recherche, soit parce qu’elle possède elle-même les brevets. De la génétique pour le fichage ADN aux micro-émetteurs jusqu’aux études sociologiques pour savoir comment faire passer la pilule, de très nombreux domaines académiques s’impliquent dans la recherche sécuritaire.
Sans rentrer dans l’analyse de ces programmes de recherche, certains outils de contrôle et de surveillance s’imposent à quiconque traverse une université. Les bâtiments sont filmés en permanence par de multiples caméras, dans les halls comme dans les amphithéâtres. L’espace public est ainsi quadrillé par des yeux électroniques et enregistreurs, qui se verront vraisemblablement dotés très bientôt de capacités de reconnaissance faciale.
L’apparition des agentes Uni-sécu dans les bâtiments est une autre manifestation visible de ce contrôle. « Créée par un noyau d’étudiants qui assument les tâches de gestion, de fonctionnement, et d’administration. La société est surtout une équipe d’universitaires qui partagent la même passion pour le domaine de la sécurité »3. Possédant un local au sein des bâtiments académiques (juste au-dessus de la Datcha), cette sympathique bande d’étudiantes a donc profité de la frénésie sécuritaire du rectorat pour obtenir un juteux contrat de surveillance de l’Université de Genève. Selon les événements, d’autres entreprises similaires sont fréquemment présentes dans l’Université. Officiant même en civil, ces agentes de sécurité se sont distinguées en expulsant d’Uni-Mail des mendiantes du quartier qui avaient l’impudence d’utiliser les toilettes. En début d’année, en faculté de médecine, elles vérifiaient les cartes d’étudiantes des premières années pour éviter un sur-remplissage de la salle, au mépris de la liberté d’assister au cours pour les non-étudiantes. Le reste de leur activité, mis à part réprimander les manantes qui poseraient leur vélo plus loin que la ligne jaune tracée près des entrées le leur permet, consiste à se pavaner en uniforme de jour comme de nuit.
Le plus inquiétant, au travers de toutes ces mesures, ce n’est pas de savoir qui assure le contrôle, qu’il soit privé ou public, ni où vont les images des caméras de surveillance, mais l’acceptation progressive d’une surveillance généralisée à laquelle elles contribuent. Personne ne s’offusque vraiment de ces transports publics quadrillés de caméras, pas plus que des passeports biométriques ou des prises systématiques d’ADN par la police. Voir une voiture de police toutes les cinq minutes ne fait pas réagir grand monde, ni les agentes de sécurité à la sortie des cycles d’orientation.
Le Gixel, Groupement des industries de l’interconnexion des composants et des sous-ensembles électroniques, expliquait dans son Livre bleu4 datant de 2003 comment atteindre son ambition de développement de l’usage de la biométrie. « La sécurité est très souvent vécue dans nos sociétés démocratiques comme une atteinte aux libertés individuelles. Il faut donc faire accepter par la population les technologies utilisées et parmi celles-ci la biométrie, la vidéosurveillance et les contrôles. Plusieurs méthodes devront être développées par les pouvoirs publics et les industriels pour faire accepter la biométrie. Elles devront être accompagnées d’un effort de convivialité par une reconnaissance de la personne et par l’apport de fonctionnalités attrayantes »5. Il encourageait ainsi l’usage de ces technologies dans les écoles maternelles afin « d’éduquer les enfants », dans les biens de consommation comme les ordinateurs ou les voitures, et dans les services comme les transports. L’Université de Genève sert les mêmes ambitions au profit de ces grandes industries et avec la bénédiction des citoyennes déjà convaincues que ce type de société est le plus à même de leur offrir la sécurité nécessaire à leur bonheur : une vie sous contrôle, du pointage du matin à la journée de travail filmée, qu’il soit celui de l’État, de l’employeur, ou d’une autre citoyenne-flic.
1L’abréviation RFID signifie « Radio Frequency IDentification », en français, « Identification par Radio Fréquence ». Cette technologie permet d’identifier un objet, d’en suivre le cheminement et d’en connaître les caractéristiques à distance grâce à une étiquette émettant des ondes radio, attachée ou incorporée à l’objet. La technologie RFID permet la lecture des étiquettes même sans ligne de vue directe et peut traverser de fines couches de matériaux (peinture, neige, etc.). (http://www.commentcamarche.net/contents/rfid/rfid-intro.php3)
2http://cartes.unige.ch/presentation/carte.html
3http://www.uni-secu.ch/about.html
4Consultable grâce à une fuite en juillet 2004 à cette adresse : http://bigbrotherawards.eu.org/article626.html
5Livre Bleu, première version, Gixel, juillet 2004, page 35.
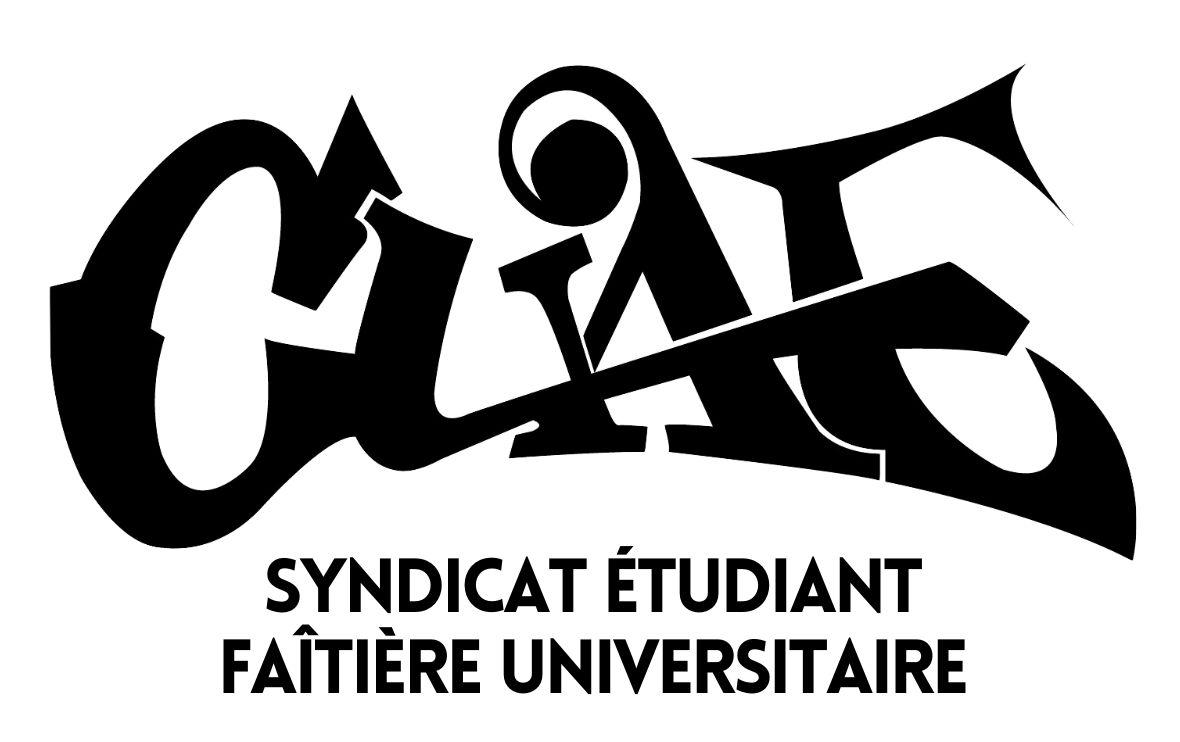
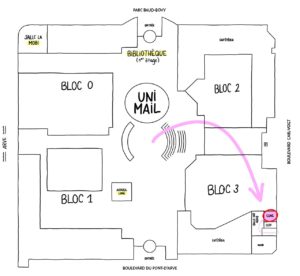
Comments are closed