Le revenu de base comme réponse offensive à la dégradation de la situation sociale des étudiantes et à la destruction du système des bourses
La situation sociale des étudiantes en Suisse est en régression constante. La majorité des étudiantes en fin d’études (82 %) [1] ont un travail rémunéré en parallèle à leurs études. Ce travail est estimé absolument nécessaire financièrement pour 57 % d’entre eux. Les difficultés posées par l’introduction du processus de Bologne sont nombreuses, puisqu’elles généralisent les études à plein temps et raccourcissent les délais d’études de façon drastique. Cette situation est naturellement à mettre en parallèle avec la diminution du financement public attribué aux bourses. Cette diminution peut également être mise en lien avec la baisse du financement public pour l’université en général, entre autres l’encadrement. En Suisse, l’Office fédéral de la Statistique [2] indique que les montants consacrés aux bourses sont en stagnation sur la période 1995-2005, ce qui correspond à une baisse de 9 % si l’on tient compte de l’inflation sur cette même période. En outre, ces chiffres ne tiennent pas compte de l’augmentation du nombre d’étudiants (16 % depuis 1990), ni des importantes différences de traitement dues au système fédéraliste (la dépense consacrée aux bourses par habitant pouvant varier dans une proportion de un à cinq selon les cantons). On peut ajouter à cela la tendance à remplacer les allocations par des prêts remboursables, certains cantons ne délivrant plus du tout d’allocation. Enfin, l’augmentation des taxes universitaires constitue la dernière attaque contre toute volonté de démocratisation des études. A Genève, les taxes sont actuellement fixées à 500 francs par semestre. Différents projets ont pour but de les augmenter, de façon généralisée ou en discriminant les étudiantes étrangères [3].
Dans ce contexte, les revendications traditionnelles telles que la gratuité des études et l’augmentation des bourses d’études (à la fois en nombre et en montant) nous apparaît comme insuffisante. L’instauration d’un véritable revenu pour les étudiantes est donc une priorité. Mais conscients que la précarité frappe des couches toujours plus importantes de la société, il nous semble incohérent de limiter ce revenu aux seules étudiantes. C’est pourquoi la CUAE souhaite que le financement des études prenne la forme d’une revenu de base généralisé et inconditionnel. Le revenu de base, ou allocation universelle, consiste en le versement à toute personne d’un montant suffisant à couvrir ses besoins élémentaires, de façon inconditionnelle, c’est-à-dire sans critère discriminant ni prestation en retour, que ce soit sous forme de travail ou autre. Il remplacerait, en tout ou en partie, certaines prestations sociales actuelles. L’institution d’un tel revenu implique la reconnaissance que l’existence sociale d’une personne n’est pas liée au travail rémunéré qu’elle fournit. En ce qui concerne les revendications spécifiquement étudiantes, le revenu de base est un pas important vers une réelle démocratisation des études supérieures. Les discriminations sur des critères socio-économiques sont actuellement importantes [4]. Ainsi, 42 % des étudiantes de Suisse ont un parent au moins ayant achevé des études supérieures, contre seulement 9 % ayant uniquement la formation obligatoire [5] , alors que ces deux catégories représentent respectivement 11 % et 21 % de la population totale. Le revenu de base apporte l’assurance de conditions de vies décentes indépendamment du soutien parental et nous paraît être une mesure propre à atténuer la reproduction sociale. Il est cependant clair que cette réduction des inégalités économiques ne saurait les supprimer complètement, et que d’autres inégalités, en particulier dans la distribution des capitaux culturels et symboliques constituent un handicap à un accès universel à la formation supérieure. Le revenu de base constitue également un atout dans la lutte contre d’autres discriminations, par exemple celles en fonction du genre ou de la nationalité.
Le revenu de base a également le mérite de constituer une proposition offensive face aux démantèlements qui frappent les acquis des étudiants. Plutôt que de se contenter de défendre le système actuel, insatisfaisant sur bien des points [6] même dans les cas où une bourse est obtenue, il semble plus pertinent de militer en faveur d’un système favorisant réellement un accès universel aux études en supprimant les barrières économiques. La lutte pour un financement inconditionnel des études est une concrétisation de « la vision alternative à la vision capitaliste de l’éducation et de la recherche scientifique » [7] voulue par la CUAE. Le choix de l’allocation universelle plutôt que du revenu étudiant permet d’étendre cette revendication à d’autres catégories de la population et de développer des collaborations avec d’autres mouvements poursuivant des buts similaires, et donc d’étendre le combat anticapitaliste à l’ensemble de la société.
Les termes au féminin de ce texte s’entendent bien entendu aussi au masculin.
[1] Stassen, Jean-François, et al., Etudiants 2004 , Université de Genève, 2005, pp. 26-27.
[2] Stagnation des dépenses pour les bourses d’études, baisse des dépenses pour les prêts d’études, communiqué de presse de l’Office fédéral de la Statistique, 26 novembre 2006.
[3] Voir en particulier les projets de loi PL 9818 et PL 9856. De plus, la loi sur l’université est actuellement en complète révision, confiée à une commission externe. Voir à ce sujet les communiqués de presse de la CUAE du 26 juillet 2006 et du 19 février 2007.
[4] Stassen, Jean-François, et al., Etudiants 2004, pp 34-36.
[5] Office fédéral de la Statistique, Situation sociale des étudiant-e-s 2005, 2006, p. 11.
[6] Par exemple l’insuffisance du montant maximal de la bourse pour subvenir complètement aux besoins du bénéficiaire, la dépendance parentale dans laquelle sont placés les étudiants, ou encore les exigences académiques (critère de normalité d’études) qui frappent particulièrement les étudiants qui doivent consacrer une partie de leur temps à un travail rémunéré.
[7] Statuts de la CUAE, article 3 : Buts.
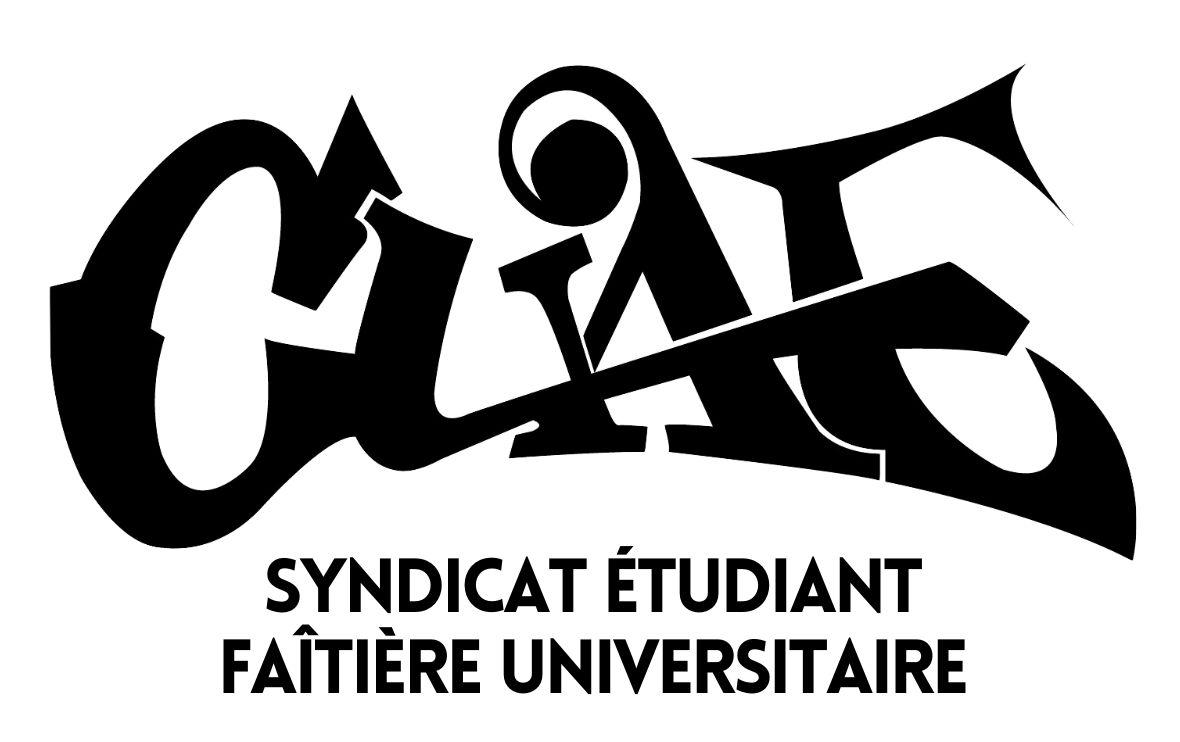
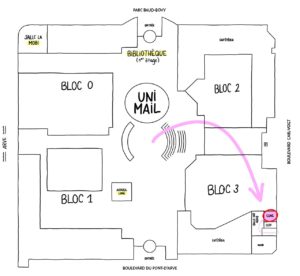
Comments are closed