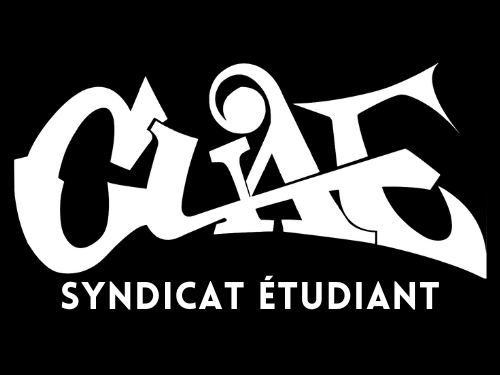Vendredi dernier était votée la future nouvelle loi sur l’université de Genève. C’était un vendredi 13. Un de ceux qui confirment les superstitions sur cette date maudite et nous font languir du retour des zombies.
Si le parlement ne s’est malheureusement pas transformé en Ghostshouse mais presque (72 votants sur 100 avec une voix contre, mais pas celle de Jean Rossiaud [1] qui n’a toujours pas réussi à prendre part au vote). Nous avons eu droit à un véritable massacre à la tronçonneuse. Avec Pierre Weiss dans le rôle de Jason, et Charles Beer comme réalisateur converti à la théologie d’un rectorat fort. Un scénario probablement co-écrit par la grande main invisible, si on se fie à son odeur néo- libérale : En vrac, désengagement de la classe politique, hiérarchisation accrue sans contrôle démocratique, ouverture au secteur privé au détriment de l’indépendance de la recherche et statut du personnel calqué sur le modèle du privé. Sans oublier la fin d’un plafond pour les taxes universitaires – mais où sont passés les engagements socialistes ? [2]
Si l’on regrettera au passage la docilité des parlementaires de gauche au sujet des taxes universitaires, que dire de leur franc soutien au reste de la loi ? Ni les vertes ni les socialistes n’ont proposé d’amendements sur un texte qui en nécessitait tant [3]
En d’autres termes, le scénario était parfaitement lubrifié, pas la moindre grain de sable sous le capot, pas la moindre trace d’opposition inscrite au PV (même pas un rapport de minorité de la commission, même pas un amendement refusé). La nouvelle loi est le fruit d’un consensus politicard et permet une nouvelle gouvernance concrétisant la cosmogonie du rectorat fort. En somme, il s’agit d’une conversion de la classe politique à une religion qui semble faire des émules au-delà des rangs de la droite classique (c’est-à-dire sans le PS et les Verts). Cela arrange tout le monde. Les députées n’ont plus de compte à rendre sur leur désintérêt quant au fonctionnement de l’institution et le rectorat, en plus d’être libéré des contingences de la démocratie interne, a les mains totalement libres pour mener la barque à sa guise. L’érection en dogme d’un rectorat surpuissant ne souffre d’aucune résistance. Puisqu’il est accepté de toutes, seules des folles peuvent nier sa supériorité. Et puisque ce sont des folles, il n’est pas nécessaire de répondre à leurs critiques, contrer leurs arguments ou prendre en compte leurs remarques. Il n’est plus nécessaire au rectorat de justifier ses propres actes ou même de les discuter. Et cela, ni devant les pouvoirs politiques ni devant des organes de démocratie interne. Seule une Assemblée, dénuée de tout pouvoir, servira de moyen de légitimation à la politique rectorale et de pseudo-organe consultatif.
Nous regretterons également l’indépendance de la recherche et ne croyons pas une demi-seconde que le conseil d’éthique et de déontologie [4] n’aura d’autres utilité que d’étouffer les futures affaires Rylander [5] Fini le temps où l’on investissait dans la recherche fondamentale et où l’on publiait ses découvertes consciente du caractère public du savoir et des débouchés futurs de cette même recherche fondamentale. Niant le caractère aléatoire ou hasardeux de la recherche scientifique dont on ne peut par définition savoir à l’avance les découvertes, on veut désormais des recherches orientées, permettant des débouchés rapides pour le secteur privé (un euphémisme bien laid pour dire les entreprises, et pas n’importe lesquelles, les plus grosses, celles qui rétribuent le mieux les actionnaires, c’est-à-dire le capital). Il en est donc fini du temps de la liberté académique et des recherches en sciences humaines pointant là où ça ne va pas ! Qui financera des recherches sur des questions comme le rôle des banques suisses dans la Deuxième Guerre mondiale, la quantification de l’écart des salaires entre les femmes et les hommes ou sur les violences policières et étatiques ? Les chercheuses deviendront des laquais au service du capital. Pour les entreprises, et donc les actionnaires, c’est « tout bénéf » : comment profiter du savoir faire et des infrastructures de l’université à moindres frais pour produire une quantité de savoir directement utilisable. Le contribuable ne pourra plus se plaindre de financer des « branleuses en étude » ou « des chercheuses trop bien payées », il financera directement les recherches des grandes firmes suisses (merci Serono pour cette chair en endocrinologie !) et la formation des futures servantes du capital (il ne faut pas chercher plus loin la demande d’inscription dans la convention d’objectifs (euphémisme pour contrat de prestations) de la création d’un pôle d’excellence en finance). Avec le recours accru au financement privé, c’est la fin de la mise à mort des dernières zombies comme la pensée critique à l’université mais aussi l’entrée dans un nouvelle ère : celle de la créativité productrice de richesse. Traduction : c’est le moment d’apprendre à faire toujours plus avec toujours moins (c’est ça être créatif) et c’est fini l’époque où l’on avait le temps de se poser des questions sur le pourquoi de faire toujours plus ? le pourquoi de devoir faire avec toujours moins ?
En bonnes jésuites, les parlementaires imposent une réforme qui n’est qu’un retour en arrière. Après avoir fabriqué une « crise de l’université » montée de toutes pièces, elles prétendent résoudre les problèmes actuels avec les recettes d’hier : fin de l’indépendance académique pour se conformer au diktat de l’économie, autorité du recteur sur une université hiérarchisée à outrance, et réaffirmation de son rôle essentiel de reproduction sociale des élites bourgeoises. La gauche parlementaire ne s’y est pas trompée et a su lire le jeu de la droite comme la direction du vent dominant. En sachant taire ses divisions pour accepter prudemment ce compromis qui vaut à ses autrices de jouir des félicitations de l’extrême-droite [6], ils ont su oublier leurs programmes nationaux concernant la gratuité des études supérieures ou l’université démocratique. Nul doute que ce pragmatisme leur vaudra la reconnaissance fugace de leurs partenaires de droite. Et le mépris des zombies et des autres.
[1] Jean Rossiaud était absent lors du vote final de la commission de l’enseignement supérieur et n’a donc pas pu jouir du droit à rédiger un rapport de minorité.
[2] Nous vous renvoyons à l’interview de Beer dans Le Courrier du 19 avril 2008 ainsi qu’au programme politique du Parti Socialiste Suisse.
[3] Bien que nous ne les regrettions pas, nous nous étions habitués à ce que l’on propose des amendements cosmétiques. Cette fois-ci, mêmes ces amendements de façade n’ont pas été proposés. Pour celles qui désirent plus d’information sur le sujet, nous les renvoyons à la proposition d’amendements du Groupe de Travail sur la Loi sur l’Université (qui a été réactualisée après les modifications apportées par la commission sur l’enseignement supérieur, c’est-à-dire quasiment rien malgré plus d’un semestre de tergiversation. A ce sujet, nous en concluons que les travaux et auditions de la commission n’ont servi qu’à augmenter la légitimation du texte de loi qui avait jusqu’à lors été rédigé que part des expertes auto-proclamées).
[4] Suite à l’affirmation de son innocence quant aux accusations de plagiat qui planait sur son travail, nous ne pouvons que suggérer la candidature du Professeur ordinaire d’éthique Monsieur François Dermange.
[5] Ragnar Rylander, un prof de la fac de médecine a été pris la main dans le sac : il collaborait depuis 30 ans avec Philip Morris et publiait des études conformes aux intérêts de l’industrie du tabac à savoir de faire croire que le tabac ne cause aucun dommage ! Voir notamment S. MALKA et M. GREGORI, Infiltration, une taupe à la solde de Philip. Morris, Genève, Editions Georg, 2005.
[6] Ainsi Eric Bertinat, membre UDC de la commission, a félicité Ruth Dreifuss et Charles Beer pour le travail accompli autour de cette loi.