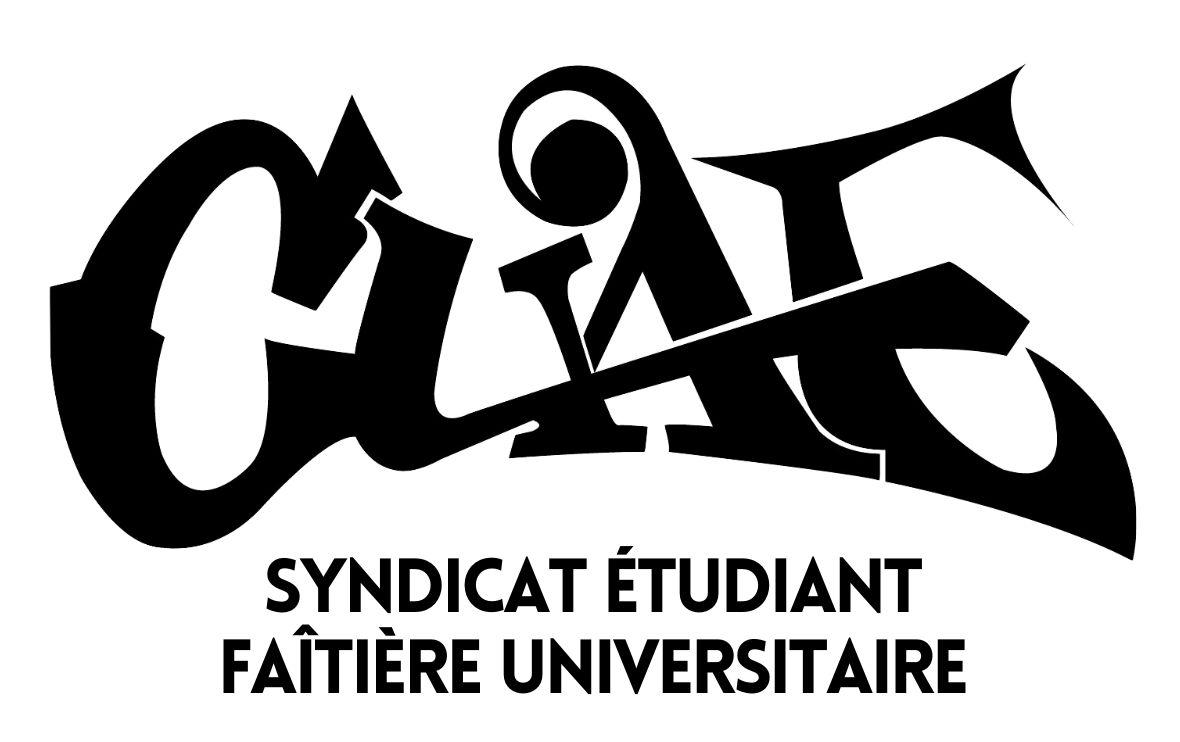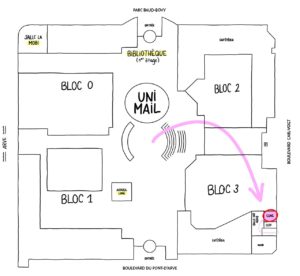L’incurie au pouvoir : les députéEs flinguent l’université
Communiqué de presse de la CUAE du 10 juin 2008[…]
Des taxes à 46’000 francs, ça vous tente ? Ou pourquoi ne pas prendre les députéEs au sérieux ?!
Vous trouverez les liens internet des projets de loi déposés[…]
Les fondements moraux de la gratuité des études
Derrière les taxes universitaires se cache un principe farfelu : marchander[…]
Les arguments "pragmatiques" pour la gratuité des études
Au-delà d’une revendication romantique qui nie la légitimité d’une marchandisation[…]
Lancement de l’initiative "Pour la démocratisation de l’Université"
Communiqué de presse – 20 novembre 2007 Genève, le 20[…]
Projet de Loi sur l’Université : Communiqué de presse de la rentrée
A l’occasion de la rentrée universitaire, la CUAE ‒ syndicat[…]
Réponse à l'article de Pierre Weiss (Le Temps, 22 mai 2007)
Vous trouvez ici la version intégrale de la réponse à[…]
Loi sur l'université: Recommandations du GTLU
Vous trouverez ci-dessous les pistes de réflexion quant à la[…]
Contribution à la réflexion sur le syndicalisme étudiant au Festival de solidarité internationale de "luttes étudiantes", 11-14 avril 2007
Le revenu de base comme réponse offensive à la dégradation[…]