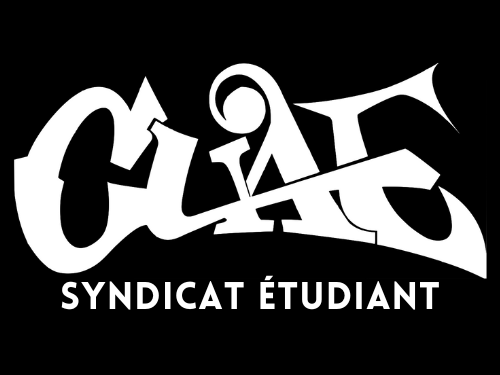Participation et consultations au pays de Candy
ou pourquoi chat échaudé craint l’eau froide
La nouvelle loi sur l’université consacre un rectorat encore plus fort qu’il ne l’était déjà. Cette concentration des pouvoirs se fait également au profit des doyennes qui sont appelées à avoir un rôle clé dans les projets rectoraux.
Il existe un certain nombre d’arguments “pragmatiques” contre la concentration des pouvoirs dans les mains d’un seul homme, même en faisant abstraction de toute critique de la conception de la démocratie qu’un tel processus reproduit. Vous les connaissez certainement : de Saddam à Staline, les exemples ne manquent pas. Aussi, plutôt que de produire un long texte théorique chiant sur l’absurdité de la délégation politique et les avantages de l’autogestion, nous préférons vous donner quelques exemples d’abus qui se produisent ici et maintenant dans l’université de Genève du XXIème siècle1…
La possibilité de lutter…
Dans l’ancienne loi sur l’université, le pouvoir des doyennes et du rectorat était contrebalancé mollement par les conseils de faculté et le conseil de l’université qui, s’ils n’étaient pas représentatifs, avaient encore des prérogatives relativement importantes notamment en matière de filières, de règlements et de programmes d’études. Toutefois, la plupart du temps, la participation des étudiantes n’a pas suffit à contrer le pouvoir des doyennes. Cela a amené à certains faits d’armes. Ne pouvant pas les retranscrire tous ici, nous rappellerons en guise d’exemple l’épisode de la suppression de la session d’examen de septembre en Lettres2 puis l’épisode du plan d’étude du Bachelor en Relations Internationales (BARI).
Le doyen des lettres a décidé au cours du semestre de printemps 2008 de supprimer la session de septembre pour la transformer en session de rattrapage. Pour ce faire, il avait besoin de l’aval du conseil de faculté. Le conseil de faculté a refusé son projet. L’histoire se serait arrêtée là si le doyen avait été respectueux des procédures et de l’avis du conseil de faculté. Au lieu de cela, fort du soutien du corps professoral, il a maintenu son projet et promulgué la suppression de la session de septembre. Heureusement, une étudiante a osé contredire le doyen et saisir le tribunal administratif dans une procédure d’opposition. Se sachant en tort, le doyen a retiré son projet pour éviter un jugement embarrassant.
Même s’il est regrettable de passer par une procédure juridique pour faire entendre le bon droit des étudiantes, il a été possible d’annuler cette décision. En passant outre le vote du conseil de faculté et une pétition largement signée par les étudiantes, le doyen s’est mis dans une position intenable, mais qui indique bien quel poids les autorités universitaires souhaitent donner au organes participatifs. Si ce genre d’épisodes bénéficiait de plus de publicité dans l’université, on entendrait sans aucun doute moins souvent des étudiantes demander à la CUAE de renforcer sa collaboration avec le rectorat et les doyennes. Il y aurait probablement une défiance légitime face aux surpuissantes doyennes et rectorat.
Une autre fois, c’est la mobilisation des étudiantes qui a permis d’obtenir ce qu’il leur était dû. Au printemps 2006, la première volée du BARI ne connaissait pas le plan d’étude de la deuxième partie du BARI (soit les deuxième et troisième année) alors même que les examens de fin de première année approchaient ! En d’autres termes, cela revenait à se lancer dans des études sans en connaître le contenu… Les étudiantes, par le biais de leur association l’AESPRI, ont alors demandé gentiment aux responsables du BARI de présenter rapidement le plan d’études pour les années suivantes de leur parcours académique. Ni les responsables du BARI, ni le doyennes, ni les professeures qui avaient toutes en leur possession le projet du plan d’étude n’ont accepté de le transmettre aux étudiantes. Fort du constat qu’on se foutait de leur gueule, les étudiantes décidèrent en assemblée d’organiser un sit-in de protestation tôt le matin devant le bureau du doyen de SES afin d’obtenir leur dû. La mobilisation a payé puisque les étudiantes ont alors obtenu en moins d’une demi-heure ce que la voie “diplomatique” n’avait pas réussi à obtenir en plusieurs semaines. La veille encore le projet du plan d’étude du BARI était soi disant classé top secret…
…Et la nouvelle loi…
Dire que les doyennes ne font pas toujours preuve d’une connaissance poussée des règlements relève donc de l’euphémisme. Sans parler de leur “bonne volonté” ou de leur “clairvoyance”… Pourtant la nouvelle loi sur l’université renforce le pouvoir de celles qui seront amenées, parce qu’elles sont désignées par le rectorat, à devenir les chevilles ouvrières des changements à venir dans l’université. L’exemple de la session de septembre en Lettres illustre bien l’accroissement de leur pouvoir : si le statut de l’uni que la première Assemblée de l’Université votera s’inspire des rapports de pouvoir au niveau de l’université pour les transposer aux facultés, le doyen de Lettres n’aura même plus besoin de l’aval du conseil de faculté pour supprimer la session de septembre!
Confiant en leur nouveau pouvoir, les doyennes n’ont pas attendu l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pour faire des projets, dont la mise en oeuvre n’est rendue possible que par la suppression du pouvoir décisionnel du conseil de faculté. L’actuel projet de restructuration de la faculté SES est un exemple. Le doyen a déjà prévu sa toute-puissance et il ne s’est même pas embêté à prendre en considération l’avis des associations d’étudiantes sur ce projet. C’est un avant-goût de ce qui sera une pratique généralisée dans un futur proche.
Demain est un autre jour
On le voit, la situation est aujourd’hui différente. Les armes aussi. Il ne nous sera plus possible de lutter à l’aide des règlements qui nous assuraient une protection, même faible. Nos pouvoirs étant extrêmement limités dans l’enceinte des conseils, il nous faudra probablement en sortir pour faire valoir le poids du nombre. Nous, les étudiantes, sommes les plus nombreuses. Il faudra peut-être le rappeler et cela peut passer par la confrontation et non uniquement, comme certaines aiment à l’affirmer, par une collaboration docile avec le rectorat au travers des procédures de « consultations ». Rappelons au passage que la Datcha a été obtenu par l’occupation du local par des étudiantes en sciences…Qui a vu les pratiques de « consultations » du rectorat à l’oeuvre sait ce que ce terme recouvre. Dans la majorité des cas, le rectorat consulte largement pour profiter des avis divergents. Ainsi, face à la multitude de positions exprimées, le rectorat a tout loisir de choisir celle qui lui convient. Et s’il n’en existe pas… il invoquera l’impossibilité du consensus pour passer es projets en force. Mais le plus souvent il ne consulte tout simplement pas. A l’intérieur des conseils comme à l’extérieur, pour la session de septembre en lettres comme pour les plans d’études successifs, l’avis des étudiantes qui sont les premières concernées n’est jamais pris en compte.
La CUAE qui cherche a mener une politique cohérente et indépendante des pressions rectorales ne peut se satisfaire d’un rôle d’étudiante alibi dans des organes dépourvues de poids décisionnel. Notre participation aux élections de la première Assemblée de l’Université peut se comprendre comme la volonté de donner un poids décisionnel à ces organes. En effet, c’est le statut que cette assemblée devra entériner en moins de 20 mois qui définira le poids des organes participatifs au niveau des facultés [3]. Ce sont également des espaces propices à la propagande, à la révélation de scandales en tout genre et souvent des sources d’informations privilégiées. Mais même avec un poids décisionnel ces organes ne seront ni représentatifs ni démocratiques. Les professeures resteront surreprésentées et empêcheront toute initiative autre que les leurs. Aussi, nous restons déterminées à agir sur les terrains que nous jugerons adéquats. Si les conseils participatifs deviennent des coquilles vides, seul restera la mobilisation du nombre ou la détermination de certaines pour que des décisions illégitimes soient combattues. Nous restons déterminées à atteindre nos objectifs de démocratisation des instances internes de l’université. Nous continuerons à lutter pour que les personnes concernées par les choix soient également celles qui décident. Nous continuerons à nous opposer à ce que les professeures ordinaires constituées en une bande d’oligarques cessent d’avoir un poids prépondérant dans les décisions de l’université. Et finalement, nous continuerons à lutter pour tout cela quelle que soit la méthode qu’ils nous laisseront à disposition.
[1] Pour un texte court et pas chiant sur l’absurdité de la délégation en politique lire « Autogestion et hiérarchie » extrait de Le contenu du socialisme de Cornelius Castoriadis. La brochure Autogestion et hiérarchie est disponible à cette adresse : http://infokiosques.net/spip.php?article247 ainsi qu’auprès de la CUAE.
[2] Contrairement à d’autres facultés la faculté de Lettres permet de choisir entre la session de juin et celle de septembre. Ainsi, celle de septembre n’est pas seulement réservée aux rattrapages et chaque étudiante peut choisir de passer son premier essai en septembre sous réserve du respect du délai d’étude.
[3] Cela constitue un des enjeux principal de l’Assemblée de l’Université qui aura un rôle consultatif contrairement au feu Conseil de l’Université.